SUSPIRIA - Dario Argento
SUSPIRIA - Dario Argento - 1977
 A Fribourg, une jeune ballerine américaine découvre que son académie de danse est un repaire de sorcières...
A Fribourg, une jeune ballerine américaine découvre que son académie de danse est un repaire de sorcières...
Même les plus basés seront scotchés à leur siège devant Suspiria. Car Dario Argento arrive à transfigurer un récit simple de magie noire et de sorcellerie
par une mise en scène digne de celle d'un véritable esthète. Il traite
l'image sans ne jamais rien laisser au hasard. Chaque détail a son
importance et tout est calculé. Tout est mis en scène, orchestré et
chorégraphié pour faire de Suspiria un monument de suspens, de gore
cruel à la limite de l'insupportable et d'esthétisme baroque parfois
sensuel.
Musique stridente, percussions, choeurs, cris, dès la sortie de l'aéroport qui forme le générique, Susy Banyon,
tout comme le spectateur, est déjà submergé dans une transe de terreur
qui rend chaque élément suspect : portes coulissantes de l'aéroport,
mauvaise volonté du chauffeur de taxi, forêt noire, éclairages, pluie
battante, bâtiment rouge de l'Académie, fuite d'une élève, refus de
Susy... Bref, outre le visuel, la musique à elle seule a déjà su créer
dès les premières secondes l'atmosphère unique de Suspiria. Sa place
prépondérante dans le film est aussi importante que le thème des Dents
de la Mer dans l'efficacité du film. Personnage, certes invisible mais
présent, la musique, avec ses hurlements effroyables, ses rythmes
particuliers, ses chants lyriques, ses gémissements et murmures,
revient aux moments les plus terrifiants. Composé par un groupe qui
s'appelle les Goblins ainsi que le metteur en scène, ce mélange hybride
de cris, d'hurlements, de sons a fait date dans l'Histoire du Cinéma
car en frôlant en grande partie l'insoutenable, cette musique
accablante et éprouvante a permit de distinguer le genre par
l'intensité avec laquelle on l'écoute.
Non seulement, la bande sonore parvient à diffuser une ambiance de
terreur mais cette entrée dans un conte de fées cauchemardesque se fait
bien évidemment par les images qui arrivent à créer du début à la fin
le climax du film d'horreur mais qui va, bien entendu, monter en
crescendo. Les décors d'une beauté dérangeante se basent sur l'ambiance
d'un rêve sans cohérence et cherchent à la recréer par sa géométrie, ses symétries
parfois suivies d'un plan décalé, et c'est cette juxtaposition qui tend
à donner cet aspect fondamental du film. Le style baroque du film
laisse place au délire et c'est dans ces décors rouges (le bâtiment de
l'Académie qui semble couler de sang) ou aux couleurs criardes qui
rappellent bien entendu le sang, la chair à vif, la mort et la violence
que vont se dérouler plusieurs meurtres atroces. La mise en scène et
ses longs travellings, ses plans hystériques, ses détails inquiétants,
ses effets gores, rendent les scènes encore plus suffocantes. Le visuel
réunit plusieurs ingrédients (cinéma, peinture, architecture avec ces
couloirs distordus presque expressionnistes, éclairages rougeoyants
bien avant ceux de Lynch, couleurs, etc) qui fusionnent pour donner cet
alliage qui émerveille autant qu'il terrifie.
Suspiria est un empilement d'effets chocs audiovisuels et de scènes cultes gores. Eventrée,
poignardée, pendue ou dévorée, les victimes connaissent tous une mort
délicatement calculée et mise en oeuvre qui ressemble presque à un
rituel. La caméra semble presque se plaire à filmer les visages
ensanglantés des cadavres de ces jeunes danseuses. Chef-d'oeuvre
baroque et d'angoisse, Suspiria est l'un des plus grands films d'horreur européen et du cinéma tout court. Les frissons y sont garantis.
Critique écrite par Clémentine le 5 novembre 2006
L'HOMME DE LA PLAINE - Anthony Mann
L'HOMME DE LA PLAINE - Anthony Mann - 1955
TRAGEDIE SHAKESPEARIENNE
Le taciturne Will Lockhart livre des vivres à Barbara Waggoman, qui possède une boutique dans une petite ville perdue en territoire apache. Il se heurte à Dave Waggoman, cousin de cette dernière et fils d'un rancher brutal et autoritaire, Alec, et se met à la recherche d'un mystérieux trafiquant d'armes, qui fournit des fusils aux Indiens...
Mercredi soir, je me rends au cinéma de Munster pour la soirée consacrée à Anthony Mann, où deux de ces westerns sont diffusés dont son plus célèbre : L'Homme de la Plaine (puisque étudié au Bac option lourde Cinéma), suivi de Je suis un Aventurier. Ce dernier étant moins réussi que le premier était néanmoins tout de même intéressant à voir selon l'approche qu'on prenait par rapport à la carrière du réalisateur afin de comprendre à quel point l'Homme de la Plaine parvient à conclure de façon grandiose la si célèbre série de westerns d'Anthony Mann : "Je voulais récapituler, en quelque sorte, mes cinq années de collaboration avec Jimmy Stewart. J'ai repris des thèmes et des situations en les poussant à leur paroxysme". Dernier des six westerns du cinéaste interprétés par James Stewart, Mann conclut sa série de films (Les Furies, Winchester 73, les Affameurs, l'Appât, Je suis un Aventurier), qui s'imposent assurément comme le sommet de l'oeuvre manienne, par l'Homme de la Plaine, quintessence du western mannien même puisque certaines lignes de forces principales sont accentuées : L'aspect quasi-névrotique du héros incarné par Stewart et la violence sadique qui caractérise les personnages principaux et leurs relations.
Will Lockart, héros qui conserve toutes les facettes du personnage type des westerns d'Anthony Mann, rappelle Ethan Edwards de la Prisonnière du Désert non pour son racisme envers les indiens mais pour sa névrose engendrée par son caractère, les déroulements du récit ainsi que son destin dont il essaye de se détacher pour renoncer à sa vocation de vengeur. Anthony Mann ne fait alors plus que ressortir l'aspect maladroit d'un personnage, mal dans son corps dont les valeurs communes à l'Amérique trouvent des fondements nettement plus sombres et pessimistes, comme la vengeance, qui rendent les protagonistes ambiguës, malades et névrotiques. James Stewart n'a pas le même physique que John Wayne et son visage angélique ainsi que toutes les prestations laissées derrière lui ne pouvaient que faire transparaître Will Lockhart comme un homme qui souffre intérieurement (dans la Vie est Belle, Stewart souffre du manque d'argent et immatériellement, du désespoir, dans Sueurs Froides, c'est de la peur du vide dont il souffre). Si Will s'est reconverti en transporteur de marchandises, ce n'était pas pour déposer sa marchandise devant Barbara Waggoman à Coronado mais bien et bel pour assouvir la vengeance qui le torture intérieurement afin de se libérer de toutes les séquelles et blessures qui recouvrent son corps. Mann suit donc suit l'aventure individuelle de son personnage, installe le spectateur quand l'intrigue débute et Stewart, d'étape en étape, mène le spectateur à sa quête de vengeresse et révèle une personnalité bien éloignée du manichéisme habituel du genre jusqu'à lui faire assister la phase ultime de la démarche de Will Lockhart.
Outre l'itinéraire individuelle et la descente aux enfers du héros, l'Homme de la Plaine doit sa réussite à la très grande richesse intérieur des différents personnages dominés par Alec Waggoman. L'enjeu dramatique où Stewart est pour la première fois humilié par Dave enclenche tout le début de violence qui va recouvrir le restant du film comme durant la séquence de la "correction" de Dave et de Vic par Stewart (l'une des scènes les plus marquantes de tout le film), pour la première fois les protagonistes sont tous rassemblés, leurs relations sont définies subtilement et les destinées, anticipées. En ce sens, l'Homme de la Plaine semble prendre des allures de grande tragédie puisque l'intrigue présentée dans une relation filiale est une libre interprétation du Roi Lear dans l'univers du western : Dave qui a du mal à reconnaître son complexe d'oedipe est le fils réel d'Alec Waggoman qui, lui, regrette d'avoir eu Dave comme fils, Vic est son fils spirituel dans lequel il place tous ses espoirs, Lockhart est le fils idéal qu'il aurait souhaité avoir mais qu'il n'aura jamais car tous deux se ressemblent (drame intérieur, anciens de la Conquête de l'Ouest, etc...). L'Homme de la Plaine arrive tant à surpasser les westerns mannien qui le précédait tant au niveau de la richesse des caractères des personnages que dans le travail du visuel. La mise en scène se déploie et ose beaucoup plus que dans Je suis un Aventurier ou les Affameurs, le sens du découpage, la participation de nombreux décors et de paysages naturels du Nouveau-Mexique, éléments majeurs de la mise en scène, sont comme sublimés par le premier emploi de Mann d'un splendide Cinémascope.
Ici, rien de drôle. Par son absence d'humour et de l'aspect « picaresque » que montraient les westerns précédents de Mann, l'Homme de la Plaine tend à se démarquer de tout ce qui le précédait tant dans cet élément que par l'aspect visuel du film et parvient ainsi donc à figurer comme le meilleur, le plus grand et le plus célèbre western réalisé par Mann car il arrive à rendre compte de la mutation de son cinéaste qui atteint là, une vision hautement plus tragique, désespérée, noire et malade d'un monde, d'un monde plein de paroxysmes, à l'image de ces personnages qui en sont hantés.
Critique écrite par Clémentine le 18 novembre 2006
LE MESSAGER - Joseph Losey
LE MESSAGER - Joseph Losey - 1971
L'AMOUR, COUPABLE D'UNE INSTRUMENTALISATION
 Un jeune garçon de milieu modeste est invité par son camarade de classe, Marcus Maudsley, à vivre le temps d'un été dans la demeure d'une une famille aristocratique britannique à Norfolk. Il tombe amoureux de la fiancée d'un vicomte. Il en devient le messager, faisant sans cesse des allers et retours entre le château et la ferme où loge son amant.
Un jeune garçon de milieu modeste est invité par son camarade de classe, Marcus Maudsley, à vivre le temps d'un été dans la demeure d'une une famille aristocratique britannique à Norfolk. Il tombe amoureux de la fiancée d'un vicomte. Il en devient le messager, faisant sans cesse des allers et retours entre le château et la ferme où loge son amant.
Lauréat du Grand Prix (Palme d'Or) à Cannes en 1971, le Messager de Joseph Losey figure comme l'une des oeuvres les plus importantes du cinéaste anglais aux côtés de The Servant et Accident! Ce terrible film s'inscrit pleinement dans le drame de l'enfance car, se déroulant dans la campagne paisible, ensoleillée et verte de Norfolk, il développe le récit d'un jeune enfant, victime d'une passion amoureuse et dont il est l'intermédiaire innocent. De ce film, on en ressort muet et encore hanté de la musique de Michel Legrand (qui sert aussi de musique au générique de l'émission « Faîtes entré l'accusé »), hanté de la (première) et dernière image que le spectateur voit du couple passionné Julie Christie et Alan Bates en train de débattre, marqué comme le sera à vie le jeune Léo, « le messager » du film. Enfin, à ce moment-là précis, Léo a compris ce que signifiait « flirter », la définition qu'il cherchait inlassablement auprès de Ted Burgess (Alan Bates, le fermier, amant de Julie Christie). En captant de splendides paysages par une caméra discrète, en même temps d'aborder le thème de l'enfance, période où tout semble être en jeu pour l'avenir, Joseph Losey, profond partisan communiste, montre l'opposition des classes et la confrontation qu'elle entraîne.
L'ouverture comme la fin du Messager permettent au spectateur de comprendre que tout ce qui constitue le film est un immense retour sur le passé. « Le passé est une terre étrangère où l'on agit autrement ». Une vitre avec des gouttes de pluie s'écoulant. Le temps a passé et il continue de s'écouler. Ces premiers mots du film proviennent de la bouche de Léo Colston, 60 ans après le terrible drame intérieur qu'il a connu durant l'été de 1900 dans un château de Norfolk. Ces premiers mots que le spectateur entend sont indéniablement des séquelles de souffrance, des cicatrices de souvenirs intérieures qui ont fait mal et qui continueront à lui faire mal toute sa vie. Les enfants sont à prendre avec des pincettes et non comme un objet ou un facteur. Et pourtant, c'est ce que vont faire Julie Christie et Alan Bates. Pour Léo Colston, le château de Norfolk était d'abord un lieu fascinant à découvrir et à connaître. Le parfait endroit pour jouer, se cacher et se perdre. Mais son camarade Marcus tombe finalement malade et Léo est amené à errer dans le château, à finir par s'ennuyer, entouré de tous ses adultes. Il se sent seul et personne ne cherche à lui parler hormis Marian, âgé d'à peu près 25 ans et dont il va tomber amoureux. Mais il se trouve qu'elle a déjà un amant malgré qu'elle soit fiancée, un « homme des bois ». Elle est presque une sorte de nouvelle « Lady Chatterley ». Et le couple va alors se servir de Léo comme « facteur », comme messager pour s'envoyer des lettres sans être vus.
En lisant une fois une de ses lettres, Léo découvre qu'ils s'aiment. Par la suite, il se refuse de continuer son rôle d'intermédiaire, déchiré par les jeux incompréhensibles des adultes qui cachent beaucoup de choses (« Qu'est ce que veut dire flirter ? »). Au final, Ted Burgess et Marian, de façon très cynique, réagissent avec beaucoup d'agressivité envers leur instrument, qui permet leurs petits plaisirs, car il pourrait nuire à leur amour s'ils ne s'envoient plus de lettres. A partir de là, Joseph Losey fait une étude et analyse approfondie de l'égoïsme inconscient des adultes par rapport à un enfant. Certes, les deux membres du couple ont de l'affection pour Léo mais son surtout contents qu'il garde le secret et serve de messager. Ne comprenant pas qu'il ne pourra jamais se faire aimé de Marian, influencé et « manipulé », il continue son rôle qui va l'amener à être le coupable indirecte de la découverte du secret de ses amours interdits par la famille aristocratique. Et cette découverte, cette seule image du couple, prenant plaisir au sexe, comme celle de Ted Burgess, mort suicidé qui suit, restent ancrée dans la mémoire du spectateur comme elle le reste dans les souvenirs de Léo à jamais marqué. Ses marques, on les lit même sur son visage en 1960, fatigué et vieux et devenu froid avec le temps. Joseph Losey montre comment deux semaines peuvent influencer l'existence entière d'une vie humaine.
Surtout que cette découverte s'est faite le jour de l'anniversaire de Léo, ce même jour où il a été tour à tour l'instrument des deux amants et de Mrs. Maudsley dont il a été l'espèse de chien qui flaire pour trouver ce qu'elle cherchait. De plus que Léo passe devant le cadeau d'anniversaire, le plus beau qu'il n'aurait jamais eu, une bicyclette verte mais qu'il ne recevra jamais. Léo n'aura jamais de bicyclette car il vient d'un milieu modeste et ne pourra donc jamais se détacher de ses souvenirs et s'envoler de lui-même. Et puis dans un flash-back, on aperçoit le fils des deux amants, et Marian, elle aussi vieillie, demande à Léo de dire à son fils qu'il peut se marier avec la femme qu'il aime. Et enfin, dans une voiture, Léo s'éloigne et observe le château de Norfolk sous une pluie battante. Ce lieu d'adultes, secrètement de sexe mais aussi d'aristocrates, endroit où il était donc totalement étranger, tout comme l'amour de Ted Burgess et Marian. Ce lieu, pour Léo, ne pouvait l'initier au monde adulte. L'expérience qu'il connaîtra l'aura vidé et instrumentalisé pour toute sa vie, incapable de donner de l'amour.
Grande tragédie et drame de l'enfance dans ses paysages de Norfolk sublimés par la caméra, le Messager est un film d'une justesse remarquable dans sa façon de tout suggérer par un scénario d'une finesse inhabituelle et dans sa manière de mettre en avant et de faire passer tout le drame intérieur qui se déroule chez Léo au spectateur pour le marquer et hanter suffisamment d'airs musicaux et d'images d'une beauté inoubliable.
Critique écrite par Clémentine le 31 décembre 2006
LE DIABLE PROBABLEMENT - Robert Bresson
LE DIABLE PROBABLEMENT - Robert Bresson - 1977
EN PLEINE PERIODE NOIRE
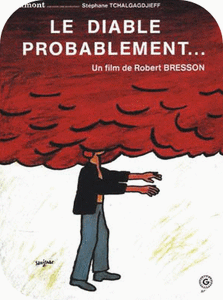 On retrouve le cadavre de Charles, vingt ans, deux balles dans la tête. Assassinat ou suicide ? Avec Michel, Alberte et quelques autres, il s'inquiétait du sort du monde, de la pollution, de la famine... Michel est militant écologiste mais Charles refuse l'engagement. Il ne voit d'autre que le suicide à l'antique dont lui parle un psychanalyste et qui, censé devoir l'aider, lui donne, sans le savoir, ironiquement "LA" solution...
On retrouve le cadavre de Charles, vingt ans, deux balles dans la tête. Assassinat ou suicide ? Avec Michel, Alberte et quelques autres, il s'inquiétait du sort du monde, de la pollution, de la famine... Michel est militant écologiste mais Charles refuse l'engagement. Il ne voit d'autre que le suicide à l'antique dont lui parle un psychanalyste et qui, censé devoir l'aider, lui donne, sans le savoir, ironiquement "LA" solution...
« - Qui est-ce donc qui s'amuse à tourner l'humanité en dérision ? Oui, qui est-ce qui nous manoeuvre en douce ?
- Le diable probablement ! »
« Ce qui m'a poussé à faire cette ½uvre, c'est le gâchis qu'on a fait de tout. C'est cette civilisation de masse où bientôt l'individu n'existera plus. Cette agitation folle. Cette immense entreprise de démolition où nous périrons par où nous avons cru vivre. C'est aussi la stupéfiante indifférence des gens sauf de certains jeunes plus lucides » tels sont les propos de Robert Bresson qui permettent de mieux comprendre son avant-dernier film Le Diable Probablement. En effet, après sa grande période créatrice (Pickpocket, le Procès de Jeanne d'Arc, Au Hasard Balthazar, Mouchette...), Bresson se plonge dans une période d'une noirceur et d'un pessimisme absolus dont témoignent particulièrement ces deux derniers films, Le Diable Probablement et l'Argent qui sont tous deux, de violents réquisitoires envers la société industrielle française qui semble être à l'origine de la perte de la conscience morale de l'homme. Charles, héros bressonien type, être d'élite comme le personnage de Michel Lasalle de Pickpocket, est l'un de ses « jeunes plus lucides » dont parle Bresson dans sa citation plus haut. C'est d'ailleurs en ça que Le Diable Probablement se situe à la limite du christique car on peut voir la figure du Christ en Charles car il est tendu vers le futur, son héros dépasse le futur qui à travers le sacrifice, se mûe spirituellement. Les héros de Bresson ont toujours une passion qui cherche à ouvrir la voie de la liberté. Mais Le Diable Probablement figurant comme un réquisitoire envers la société, son héros ne peut trouver la voie de la liberté, si ce n'est peut-être par la mort, car le problème de Charles se trouve être le conflit entre le monde extérieur violent et l'intérieur de son esprit. Le monde extérieur de tous les films de Bresson semble empêcher la fabuleuse liberté de l'esprit. Le film parle de marxisme, d'écologie, de psychanalyse et de bien d'autres thèmes, de drogue, d'intégrisme, de pollution, bref de problèmes contemporains toujours approfondis mais surtout de la crise générationnelle à venir que Bresson qualifie de « vertige suicidaire de notre civilisation ». La caméra épouse la perception subjective de Charles et Bresson ne décrit jamais le monde extérieur pour décrire le monde extérieur, ni pour lui-même mais pour s'en servir comme cadre à l'évocation de l'évolution intérieure des personnages. Il évite toujours de décrire inutilement le monde extérieur, Bresson refuse ça et préfère aller à l'essentiel. C'est ça son espace-temps. La brièveté des plans et l'utilisation de nombreuses ellipses qui transportent le spectateur d'un point à un autre le démontrent. Le Diable Probablement n'est sans doute pas l'idéal pour découvrir Robert Bresson car difficile d'accès (d'ailleurs, ce film est assez complexe et ma critique vraiment pas terrible car je passe à côté de beaucoup de choses !) comme tous ces derniers films, à savoir Lancelot du Lac et l'Argent mais il s'avère être indispensable pour explorer davantage cet auteur. (Le film a été interdit aux moins de 18 ans car, soi-disant, il incitait au suicide !)
Critique écrite par Clémentine le 10 mars 2007
PICKPOCKET - Robert Bresson
PICKPOCKET - Robert Bresson - 1959
UNE DATE CLE DANS L'HISTOIRE DU CINEMA

L'itinéraire de Michel, jeune homme solitaire, fasciné par le vol, qu'il élève au niveau d'un art, persuadé que certains êtres d'élite auraient le droit d'échapper aux lois.
« - Est ce que vous vous sentez seul ?
- Je me sens très seul mais je ne prends aucun plaisir à me sentir seul » répond Bresson lors d'une interview concernant Pickpocket et le cinématographe. Une réponse qui est une sorte de marque de souffrance, une séquelle cachée au plus profond de cet auteur si mystérieux dont on sait très peu de sa vie privée. Ses notes sur le cinématographe sont elles-aussi « des mots de cicatrices, des marques de souffrances, des joyaux » écrit Jean-Marie Georges Le Clézio dans la préface du livre « Dans notre nuit, ils brillent comme des étoiles, nous montrant le simple et le difficultueux chemin vers la perfection. » Et qu'y a t-il dans Pickpocket ? Qu'est ce qui marque le plus lors du premier visionnage d'un grand film de Bresson ? L'absence d'impureté, l'absence d'artifices, d'acteurs : du « faux » et de la simple et bête imitation de la vie. Mais la présence de « modèles », de « l'anti-jeu » d'acteurs (généralement) non-professionnels et la captation du « vrai », du réel, de l'humain, de « l'accident » (un regard par ci d'un modèle qui n'était pas prévu par le cinéaste). Il faut observer le visage du pickpocket pour s'en rendre compte, la lueur de joie qui brille dans son regard comme le spasme qui crispe son visage à chaque vol. Là où le spectateur s'attendait à voir un comédien, il fait la rencontre d'un homme. Et puis il y a le portrait en mouvement de ce pickpocket, le portrait intérieur traduit par la réalité subjective que projette la caméra qui est devient l'oeil du pickpocket. C'est l'intérieur qui commande, ce sont les n½uds, les mouvements de l'âme qui donnent au film son mouvement et son rythme. Les plans sont aussi brefs que les dialogues. Le film ne dure qu'une heure et douze minutes car il ne comporte que l'essentiel et chaque plan, chaque geste et chaque dialogue est chargé de sens et semble avoir été minutieusement préparé. Le film pénètre l'âme du spectateur s'il est assez attentif et fasciné par ce personnage singulier car un détournement de regard et Pickpocket est alors dénué de signification. La séquence de la gare de Lyon est la plus belle, la plus maîtrisé et la plus magistrale séquence du film, une sorte de ballet très audacieux d'une grande agilité et d'une grande virtuosité, avec toutes ces mains posés et qui se glissent dans les sacs, ces mains voleuses de pickpocket qui forcent l'homme à les suivre. Le film s'achève brusquement sur une note de tendresse humaine elle-même surprenante après un si long refus de sentimentalité et là, l'émotion est à son paroxysme. L'émotion provoquée dans les films de Bresson tiennent à la fois du mystère et du miracle, et si elle parvient à naître de l'austérité, c'est parce que Bresson arrive à s'exprimer avec les moyens du « cinématographe », à exprimer l'inexprimable, ce qu'on ne peut dire avec les mots, les formes et les couleurs. Dans Pickpocket, il crée l'atmosphère inexplicable qui naît de la présence d'un voleur. Et c'est la façon dont Bresson arrive à la créer, avec des rapports d'images et des sons, qu'elle figure peut-être à elle seule comme l'un des plus grands mystères de l'Histoire du cinéma. C'est avec les films de Bresson qu'on peut réellement parler de lmagie dans l'image. Il ne l'a jamais été dit, ou du moins peu mais Pickpocket, chef-d'oeuvre absolu est incontestablement une oeuvre-clé et une grande date dans l'Histoire du cinéma. Tous les films de Bresson qui le précédaient n'étaient que des sortes de brouillons, d'essais pour atteindre cette perfection, cette pureté, et l'Argent sera une sorte de « suite », de dérivé de Pickpocket encore plus extrême et austère, avec l'argent comme élément presque érotique, mais qui invite le spectateur à revoir sa vision du cinéma. Car renier Pickpocket, ce serait renier le cinéma comme art autonome.
Critique écrite par Clémentine le 7 mars 2007
FELLINI-ROMA - Federico Fellini
FELLINI-ROMA - Federico Fellini - 1971
REGARD AMOUREUX ET SATIRIQUE SUR ROME, L'ETERNELLE
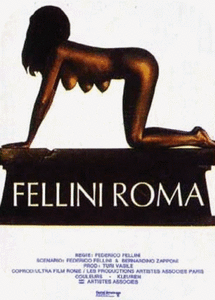 La vie à Rome de 1930 à nos jours, vue par un de ses admirateurs, Federico Fellini. Fresque monumentale où réalite et fantasmes du réalisateur sont étroitement mêlés.
La vie à Rome de 1930 à nos jours, vue par un de ses admirateurs, Federico Fellini. Fresque monumentale où réalite et fantasmes du réalisateur sont étroitement mêlés.
Sur l'affiche de Fellini – Roma, c'est le cinéaste, nourri par cette ville, dont il en parle comme une femme, aux multiples facettes : la Rome antique, la terre originelle, la mère nourricière et la femme mythique. Cette dernière étant incarnée par Anna Magnani qu'il rencontre en fin de film « Federico, oh ! Arrête tes bêtises ! Va te coucher ». Ainsi donc, Fellini nous raconte. Rome et lui, c'est une grande histoire d'amour. Rome, c'est sa « Mama » ! Dans Fellini – Roma, en évoquant son amour de toujours sous un autre point de vue que celui de l'objectivité, il se demande « Mais qu'est ce que Rome ? ». Il n'apporte pas de réponse car selon lui, « Rome est insoluble ». Mais il se sert de cette question comme prétexte à créer une succession de séquences entre rêve et réalité, entre mémoire et imagination. La Rome de Fellini – Roma est celle, telle qu'il la voit, sans doute idéalisée, avec ses habitants et l'ambiance qui en ressort. Déclaration, chant d'amour, sérénade, farce, album-photos, livre d'images et de souvenirs : Fellini – Roma, c'est tout cela.
Le film, d'une incroyable richesse, est peuplé d'une multitude de personnages, situés en haut et en bas de l'échelle sociale, du pape onctueux aux vieilles prostituées aux seins pendants felliniens, des hippies non violents au petit peuple des faubourgs. Fellini – Roma est un exemple type de la chasse fellinienne aux portraits. Il jette au spectateur une multitude incroyable de visages atypiques et singuliers de romains affreux, sales et méchants, des beaux et des laids, des obèses et des difformes. Mais il décrit les romains, ces enfants qu'il aime comme le ferait un caricaturiste et avec une tendresse intransigeante. Sa peinture de la société romaine est faite tantôt avec un humour tendre, tantôt avec un humour féroce et Fellini n'hésite pas à jouer sur la caricature à outrance pour dresser les portraits de toutes ces gueules de Rome et tourner en dérision le snobisme intellectuel dans une succession de grands moments de cinéma à couper le souffle à force de virtuosité, de maîtrise du mouvement et des couleurs. Rome d'hier, Rome d'aujourd'hui, Rome est la ville éternelle. Elle meurt mais finit toujours par ressusciter.
« Toutes les routes mènent à Rome ! » Cadavres d'animaux, tanks, charrettes, vieilles peaux difformes se maquillant dans leur voiture, voilà tout ce qu'on peut y trouver sur ses routes, à l'image de sa ville, totalement bordélique, enjouée et décadente. Et renonçant à toute structure narrative (comme ce fut déjà le cas pour la Dolce Vita), Fellini – Roma se constitue de plusieurs séquences qui n'ont aucun rapport entre elles (si ce n'est, qu'elles se déroulent, évidemment, toutes dans la ville de Rome) et qui se déroulent à des époques différentes. Et il est de toute façon inévitable que ces séquences soient finalement qualifiées de « tableaux », car cette suite fantastique conduit le spectateur des catacombes aux maisons closes de l'Italie fasciste, des théâtres miteux au défilé de mode écclesiaste (« les vêtements religieux ont évolué dans des tissus modernes nécessitant aucun repassage ! ») pour finir dans le ballet des motocyclistes dans la nuit romaine. Cette Rome qu'il construit est le résultat d'un mélange baroque de souvenirs, de choses vues, d'obsessions familières.
Haute en couleurs, la Rome que décrit Fellini est aussi la Rome de la déchéance et de l'Apocalypse que Fellini voit venir. Même s'il l'adore avec passion, le Maître de ce cirque, de cette foire grandiose se moque de la cité impériale avec une angoisse profonde. Bien qu'amoureusement filmée, elle est Enfer, dans la mesure où elle est non seulement une capitale moderne déchirée entre ses désordres et paroxysmes mais surtout pathétique résumé du destin de la civilisation chrétienne occidentale : un passé prestigieux, un présent décadent et pour le futur, la menace d'une catastrophe inévitable. Deux mille ans de civilisation ne sont-ils pas en train de disparaître ? Que font ces constructeurs à part détruire leur propre patrimoine culturel en mettant des fresques, découvertes par hasard, au contact de l'air ? Fellini – Roma, en même temps d'être l'ironique évocation de Roma, est aussi l'ironique évocation de notre temps et la satire des manifestations ostentatoires de notre vie sociale.
« Quel merveilleux endroit que cette ville, plusieurs fois morte et ressuscitée, pour attendre l'Apocalypse ! » Ce dialogue à lui seul pourrait résumer l'angoisse profonde de Fellini, tellement profonde chez lui qu'elle en est même devenue l'une des thématiques majeures de son cinéma. Déjà la Rome de la Dolce Vita qu'il décrivait en 1960 était apocalyptique, désenchantée et éclatée. Mais cette Rome, il l'aime. Il l'aime comme si il avait été nourri par elle depuis sa naissance. Fellini – Roma frappe par l'ampleur de son architecture, par l'harmonie grandiose de ses proportions, par l'originalité avec laquelle se manifeste le tempérament de son architecte, par l'humour et esprit typiquement felliniens. Fellini le magicien a mis pêle-mêle dans son chapeau de prestidigitateur les cartes de la mémoire, de la caricature, du surréalisme, de la férocité, de la tendresse et de l'humour. Il secoue le tout, puis en tire un long-métrage, ou son univers plutôt, qu'il montre aux foules éblouies ou exaspérées.
Critique écrite par Clémentine
LES 1001 NUITS - Pier Paolo Pasolini
LES 1001 NUITS - Pier Paolo Pasolini - 1974
 Interprétation par Pasolini de quelques contes des "Mille et Une Nuits" en une série d'histoires à tiroirs. "Ce qui m'a inspiré, c'est de voir le destin a l'oeuvre activement, en train de décaler la réalite, non pas vers le surréalisme et la magie... mais vers la déraison révélatrice de vie, qui ne prend un sens que si l'on fait un film réaliste, rempli de poussière et de visages pauvres. Mais j'ai fait aussi un film visionnaire ou les personnages sont dans un état de ravissement et poussés, malgré eux, par un désir anxieux de connaissance dont l'objet est ce qui leur arrive..."
Interprétation par Pasolini de quelques contes des "Mille et Une Nuits" en une série d'histoires à tiroirs. "Ce qui m'a inspiré, c'est de voir le destin a l'oeuvre activement, en train de décaler la réalite, non pas vers le surréalisme et la magie... mais vers la déraison révélatrice de vie, qui ne prend un sens que si l'on fait un film réaliste, rempli de poussière et de visages pauvres. Mais j'ai fait aussi un film visionnaire ou les personnages sont dans un état de ravissement et poussés, malgré eux, par un désir anxieux de connaissance dont l'objet est ce qui leur arrive..."
L'Italie de Boccace, l'Angleterre de Chaucer et maintenant l'Orient médiéval des contes des 1001 Nuits. Pasolini y poursuit le même propos qu'il avait exploré dans les deux riches recueils de fables populaires du Décaméron et des Contes de Canterbury en s'ancrant cette fois-ci dans un réel, tremplin pour montrer l'universalité et l'intemporalité du langage du corps ainsi que pour mieux entraîner le spectateur au-delà du fabuleux en s'éloignant comme à son habitude du naturalisme. La réalité, cette fois-ci, est orientale. Paysages, villes, populations, Pasolini a fait voyager sa caméra au Népal, en Ethiopie, en Iran, au Yémen et en Erythée à la recherche de ses décors et de ses personnages, à l'écart des grandes villes, des circuits touristiques et comme préservés de l'histoire, vrais. Vérité quotidienne de la rue, des souks, des hammams, des marchés, des caravanes. Vérité de la lumière et du temps : la nuit, l'aube, le crépuscule. Vérité des visages (à l'exception des deux complices Pasolinien : Ninetto Davoli ; et Franco Citti qui, comme d'habitude, fait une apparition de grande allure) qui se fusionnent avec la beauté des paysages et de l'architecture pour créer une harmonie, celle des 1001 Nuits selon Pasolini. Il apparaît derrière tous ces contes, en filigrane, la peinture d'une civilisation, celle de l'Islam médiévale qui semble avoir fascinée Pasolini. Plus de paillardises, ni d'humour gras et grossier qui étaient nécessaires à la vérité populaire du fabliau à l'italienne ou à l'anglaise du Décaméron et des Contes de Canterbury, les 1001 Nuits se différencient totalement des deux volets qui le précédaient car la poésie est davantage fleurie. Cette poésie se fonde en partie sur le verbe dont la puissance est vénérée jusque dans la présence matérielle que peuvent lui assurer la calligraphie ou la récitation. Il est d'ailleurs regrettable que Pasolini ait écarté les dialectes locaux ou même l'arabe au profit de l'italien pour accentuer la couleur populaire de son film. Porté par la beauté du texte auquel Pasolini se réfère, le cinéaste est soulevé par l'extraordinaire splendeur des lieux : cités yéménites, mosquées, déserts arabiques, jardins, etc préparent le spectateur à ce riche et unique poème visuel dans la carrière de Pasolini, orchestré avec des sourires, des rires et des caresses. Les personnages sont peints avec beaucoup de tendresse, de mélancolie et d'humanité et offrent peut-être au spectateur les plus belles scènes érotiques de la Trilogie de la Vie. Pasolini a fait l'économie d'une récitante célèbre : Schéhérazade car Schéhérazade, c'est lui. Au terme de sa Trilogie de la Vie, Pasolini chante la beauté et l'amour qui ne sont nullement abstraits mais bien physiques : incarnés dans la chair des paysages et des architectures, des visages et des corps, beauté et amour ignorants et délivrés des canons occidentaux et de la morale chrétienne. L'amour que l'on peut éprouver ne tient ici plus compte des contraintes imposés par nos bigoteries. Difficile de se lasser d'un pareil hymne à la jeunesse rieuse, amoureuse, ingénue, à la volupté délicate et à la sensualité sereine. Dieu est présent, moteur du fatalisme des personnages, des rencontres, disparitions, quêtes et retrouvailles. Les bonheurs du rêve, les délices de l'imagination, Pasolini nous les fait goûter à bord d'un tapis volant et semble s'enivrer, s'enchanter de ce qu'il invente. Plaisir de conter, de s'abandonner à la rêverie et à l'imagination, de s'enfoncer dans un récit sans fin qui, chaque fois, en traînent un peu plus loin le poète et ses auditeurs. Certes, le sexe continue de jouer ici un rôle majeur et l'auteur ne résiste jamais au plaisir de montrer les ébats de ses héros mais le film est aussi l'histoire d'une initiation vers l'amour (voir le splendide conte d'Aziz et d'Aziza). Sans doute, Pasolini décevra ceux qui imaginent le Moyen-Orient à travers les dérèglements de leur imagination car au contraire, c'est vers une pureté de l'amour que semble se diriger Pasolini, une pureté naturelle, une sorte d'innocence retrouvée que l'amour soit hétérosexuel, homosexuel ou incestueux.
Critique écrite par Clémentine avec Emilie, Laura et Mélody les 4, 5 et 6 mars 2007
LES CONTES DE CANTERBURY - Pier Paolo Pasolini
queLES CONTES DE CANTERBURY - Pier Paolo Pasolini - 1972
L'Angleterre au moyen-âge. Dans une auberge d'un faubourg de Londres, un écrivain assiste au récit d'une série d'histoire grivoises et décide de les rédiger par après dans un manuscrit.
(Aujourd'hui, Pasolini aurait 85 ans !). Second volet de la Trilogie de la Vie, les Contes de Canterbury est l'adaptation d'une série d'histoires écrites au XVè par l'auteur, poète et philosophe Geoffrey Chaucer. Si le Décaméron se déroulait dans les rues moisies, pleines de lumières crasseuses de Naples, dans le sud de l'Italie des sous-prolétaires (contrairement au livre qui prend place à Florence), les Contes de Canterbury prennent pour cadre l'Angleterre médiévale baignée d'une brume lumineuse. Pasolini a choisi de prendre les écrits de Geoffrey Chaucer, certes il s'agit d'un auteur d'une autre culture et on pourrait penser qu'il manque l'âme italienne, mais très inspiré par son contemporain Giovanni Boccace et « les rapports entre le réalisme et la dimension fantastique sont les mêmes » dit Pasolini « mis à part que Chaucer était plus grossier ; d'autre part, il était plus moderne, puisqu'en Angleterre, il existait déjà une bourgeoisie. C'est à dire qu'il existe déjà une contradiction : d'un côté, l'aspect épique avec les héros grossiers et plein de vitalité du Moyen-Âge, de l'autre côté l'ironie et l'autodérision, phénomènes essentiellement bourgeois et signes de mauvaise conscience ». En effet, les Contes de Canterbury est déjà l'occasion pour Pasolini de montrer clairement la confrontation des classes en jouant sur la caricature outrancière et le ridicule de ses bourgeois. Par après, l'un des éléments, sous-entendu par Pasolini plus haut, amusant et important car il permet de relier les Contes de Canterbury au Décaméron, est la mise en abyme : dans les Contes de Canterbury, on y voit Geoffrey Chaucer (interprété par Pasolini) lire avec beaucoup d'enthousiasme son contemporain Boccace, le Décaméron dans les mains : c'est le regard de Pasolini sur Chaucer regardant Bocacce. Et l'inspiration du Décaméron est la même que dans les Contes de Canterbury, Pasolini cherche encore à faire surgir le contemporain du passé en s'efforçant de faire ressusciter le peuple dans sa réalité naturelle dont seule la passion du sexe les anime (« Nul part dans l'évangile on nous voit exiger la virginité, et pourquoi a t-on des organes génitaux ?! Si on en a, c'est pour s'en servir ! Si ça vous chante, vous n'avez qu'à croire qu'ils ont été crée seulement pour pisser ! ») . Il s'agit encore là d'un film très visionnaire, « plus chrétiens que les chrétiens, plus communistes que les communistes, plus païens que les païens ». Les thématiques des Contes de Canterbury sont les mêmes que dans le Décaméron, sexe, amour, corps, vie et mort, mais cette dernière est davantage soulignée et représentée avec une scène de condamnation à mort ou de moribond mais surtout avec la magistrale représentation de l'enfer, grossière et vulgaire, dans l'une des dernières séquences du film. On y sent l'inspiration sûre des tableaux de Jérôme Bosch, du triptyque du Jardin des Délices ou de la Nef des Fous, ou même de Bruegel et de tous les primitifs flamands. La représentation de l'artiste et de sa création (comme c'était déjà le cas dans le Décaméron avec le peintre Giotto) crée un fil conducteur qui relie chaque nouvelle, chaque conte. A chaque fois le film s'achève sur la création terminée d'une oeuvre, Giotto sur sa peinture en finissant par dire « Pourquoi réaliser une oeuvre alors qu'il est si beau de la rêver ? » et Chaucer, son roman « Amen ». Dans les styles naïf, surnaturel et parfois pamphlétaire, Pasolini parle encore de corporéité populaire mais le but était d'avant tout « J'ai raconté ces contes pour la joie de raconter ». Les Contes de Canterbury est à la fois plus burlesque avec ces références au slapstick (Ninetto Davoli, à nouveau présent, en sorte de Charlie Chaplin, avec encore Franco Citti et pour la première fois Laura Betti, la grande amie de Pasolini déjà vue dans Théorème) mais aussi plus sombre avec la présence des bourgeois montrée avec beaucoup d'ironie mais aussi avec beaucoup de réticence, avec cette suite grossière de sketchs voir presque malsaine (la scatologie n'y est pas crainte à nouveau) qui frôle avec le surnaturel ainsi qu'avec la représentation terrible de la mort et du diable. Une grande paillardise dont le niveau de qualité se situe au même que celui du Décaméron. Ours d'Or à Berlin en 1972.
Critique écrite par Clémentine avec Laura, Emilie et Melody




